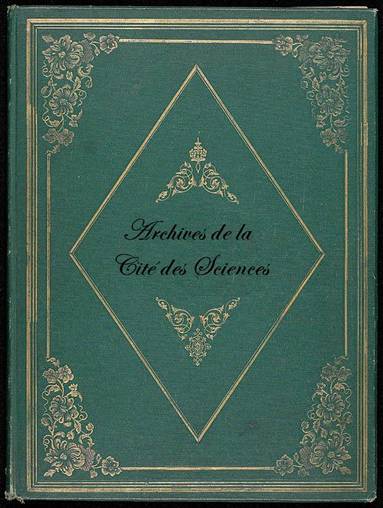
Page 1
Étude de la vision chez les animaux
Quelles relations existent-il entre les différentes propriétés de la vision des animaux et leur mode de vie ?
Introduction à la vision
Compte tenu de la diversité des moyens visuels et du mode de traitement des informations reçues du système nerveux, il n’est guère étonnant que les capacités visuelles soient très différentes, qualitativement et quantitativement, d’un animal à l’autre.
De plus, la sensibilité à la lumière a pour origine un pigment sensible aux photons lumineux. Lorsque ce pigment est frappé par les photons, le rétinal subit une isomérisation stéréochimique, c’est à dire un changement de forme, et devient trans-rétinal. Cette modification est le point de départ d’une cascade de réactions physico-chimiques qui vont assurer la transformation du signal lumineux en signal biologique. Certaines neurones ganglionnaires sont sensibles aux différentes couleurs, aux mouvements ou aux contrastes. L’analyse finale de l’image et tout particulièrement son aspect stéréoscopique, est réalisée dans l’aire cérébrale du cortex occipital.
Page 2
Dans un œil de mammifère, l’iris règle la quantité de lumière admise dans le système oculaire, le cristallin réfracte les rayons lumineux pour les faire converger sur la rétine. Cette dernière contient des pigments photosensibles.
Mais l’œil est un organe qui a évolué au cours du temps comme le montre cet axe de complexité :
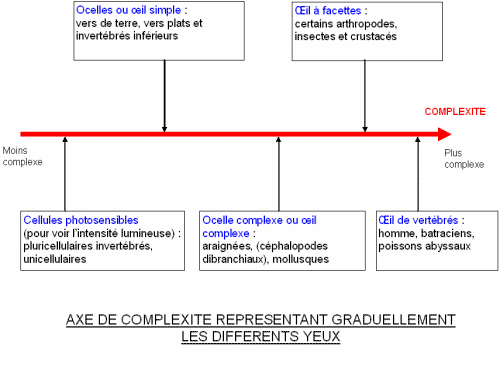
Page 3
Notre problématique se propose d’étudier les relations entre les différentes propriétés de la vision des animaux et leur mode de vie.
Nous avons choisi de regrouper ces propriétés en trois caractéristiques principales : la perception de l’intensité lumineuse, la vision des couleurs et celle des reliefs et du mouvement.
Le mode de vie prend en compte les différentes caractéristiques du
milieu : le climat, le mode d’alimentation (herbivore ou carnivore), de déplacement (dans l’eau, l’air ou sur la terre), de reproduction, la quantité de lumière présente …
Nous découperons alors notre étude entre trois parties.
Plan de l’étude
I- Quelles relations existent-il entre la perception de l’intensité lumineuse chez les animaux et leur mode de vie ?
II- Quelles relations existent-il entre la vision des couleurs chez les animaux et leur mode de vie ?
III- Quelles relations existent-il entre la vision des reliefs et du mouvement chez les animaux et leur mode de vie ?
Hypothèses
I.I. PI. Plus un animal vit dans un environnement sombre, plus il perçoit les faibles intensités lumineuses.
II.II. La vision des couleurs est une source de renseignements qui aide l’animal à réagir face aux dangers qui l’entourent.
III.III. La vision des reliefs et la perception des mouvements varie selon la vulnérabilité de l’animal
Page 4
I. La perception de l’intensité lumineuse
Hypothèse :
Plus l’animal vit dans un environnement sombre, plus il perçoit les faibles intensités lumineuses,
Sous problème :
Sachant que la vision dépend de la quantité de lumière qui arrive sur la rétine, comment se fait-il que certains animaux voient dans l’obscurité ?
1- Conditions de vision de nuit
On peut faire une constatation familière chez l’Homme : par une nuit sans lune, la vision est très floue et dépourvue de couleurs. Elle est donc limitée aux tons gris et noirs. Ainsi, notre vision de nuit empêche la discrimination des longueurs d’onde, elle permet seulement celle des différences de luminosité.
Pour reproduire les conditions d’une vision de nuit, une expérience peut être réalisée dans une chambre obscure :
On dispose d’un prisme triangulaire en plâtre, qui reçoit de la lumière de deux sources différentes (une à droite, une à gauche), comme le montre le schéma 1 :

Page 5
L’observateur est placé derrière un diaphragme percé d’une ouverture circulaire ; il voit ainsi deux demi-cercles (schéma 2).
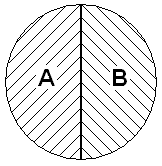
Les longueurs d’onde A et B sont normalement perçues comme bleue et jaune. Avant l’expérience, l’intensité des lumières est réduite, devenant si faible que les deux champs sont à peine visibles pour un sujet adapté à l’obscurité.
Le résultat de cette expérience est que l’observateur est incapable de dire quelle est la lumière bleue et quelle est la jaune.
2- Différentes acuités visuelles
Une expérience a été réalisée par le scientifique M. Dice (1945) : il a mesuré le plus faible éclairement auquel un hibou fond sur une souris blanche morte et conclut que certaines espèces de hiboux sont capables de voir des objets à des niveaux d’éclairement qui sont compris entre un dixième et un centième de ceux qui sont exigés par la vision humaine.
Voici les deux raisons qui expliquent ce phénomène :
Chez le hibou, le rapport entre le diamètre de la pupille et la longueur focale de l’œil est plus grand que chez l’homme, en sorte que l’éclairement de la rétine est plus élevé.
Les longs bâtonnets du hibou peuvent absorber une plus grande partie de la lumière que les bâtonnets humains.
Ainsi une nuit sombre pour nous est dix fois plus claire pour le hibou. C’est pourquoi l’expression « obscurité complète » est à relativiser : elle signifie obscurité complète pour les humains, mais pas absence complète de lumière. De même, le seuil visuel absolu du chat a été mesuré, et les résultats indiquent que la sensibilité moyenne du chat est environ 6 à 7 fois plus grande que celle de l’homme.
Page 6